Afficher le sommaire Masquer le sommaire
- L’accord franco-algérien de 1968 : un régime d’exception
- Séjour en France : des conditions assouplies pour les Algériens
- Regroupement familial : un cadre plus favorable
- RSA et minimum vieillesse : des droits immédiats et facilités
- Retraites françaises versées en Algérie
- Un coût global estimé à deux milliards d’euros par an
- Une immigration majoritairement familiale et concentrée
- Une crise diplomatique d’une ampleur inédite
Le 30 octobre 2025, l’Assemblée nationale a adopté de justesse une proposition de résolution déposée par le Rassemblement national, demandant la dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968. Le texte, voté à 185 voix contre 184, constitue une première dans l’histoire parlementaire française pour le parti d’extrême droite. Ce vote intervient dans un climat de tensions diplomatiques majeures entre Paris et Alger, et ravive un débat sensible : les avantages spécifiques accordés aux ressortissants algériens vivant en France. Peu connu du grand public, l’accord de 1968 leur confère un statut dérogatoire au droit commun des étrangers non-européens.
A LIRE AUSSI
Franco-algérien et gardien de la paix : le témoignage de Kader, entre fierté et désillusion
L’accord franco-algérien de 1968 : un régime d’exception
Signé six ans après l’indépendance de l’Algérie, l’accord du 27 décembre 1968 — modifié par trois avenants en 1985, 1994 et 2001 — encadre les conditions de circulation, de séjour et d’emploi des ressortissants algériens en France. Il instaure un régime juridique spécifique, distinct de celui appliqué aux autres étrangers extra-européens. Initialement conçu pour encadrer l’immigration de travail dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il visait aussi à préserver les liens privilégiés entre la France et son ancienne colonie. Aujourd’hui, il fonde une série de droits que certains qualifient de « privilèges », au cœur des débats politiques.
Séjour en France : des conditions assouplies pour les Algériens
L’un des principaux avantages de l’accord de 1968 concerne l’accès au certificat de résidence de dix ans. Alors que le droit commun impose cinq années de présence régulière, les ressortissants algériens peuvent l’obtenir après seulement trois ans. Ce titre leur donne un accès direct à toute activité professionnelle et bénéficie d’un renouvellement automatique. Certaines catégories peuvent même y prétendre de plein droit : conjoints de Français après un an de mariage (sans exigence de vie commune), parents d’enfants français mineurs, ascendants de citoyens français, ou encore bénéficiaires d’une rente d’accident du travail.
Depuis 2001, la primo-délivrance de ce titre est gratuite pour les Algériens, alors qu’une taxe de 225 euros s’applique aux autres étrangers. Par ailleurs, une disposition unique permet à un ressortissant algérien en situation irrégulière de régulariser sa situation après dix ans de présence continue en France, même s’il est entré sans visa.
A LIRE AUSSI
France-Algérie : vers une rupture définitive ?
Regroupement familial : un cadre plus favorable
L’accord de 1968 assouplit également les conditions de regroupement familial. Les ressortissants algériens peuvent en faire la demande après seulement douze mois de résidence, contre dix-huit pour les autres nationalités. Les membres de leur famille reçoivent un titre de séjour de même durée que la personne qu’ils rejoignent, ce qui permet d’obtenir directement un certificat de dix ans.
Une autre spécificité majeure réside dans le mode de calcul des ressources nécessaires. Le seuil reste fixé à un SMIC mensuel sur douze mois, quel que soit le nombre de personnes à regrouper. Surtout, les prestations sociales — RSA, ASPA notamment — sont prises en compte, contrairement au droit commun. Cette exception rend le regroupement familial accessible à des personnes sans emploi stable, voire allocataires. Selon l’Institut français pour la recherche sur les administrations publiques (IFRAP), cette disposition rend le droit au regroupement familial quasiment opposable à l’administration.
RSA et minimum vieillesse : des droits immédiats et facilités
Les accords bilatéraux de sécurité sociale signés en 1980 entre la France et l’Algérie garantissent l’égalité de traitement entre ressortissants français et algériens en matière de protection sociale. En pratique, cela signifie que les Algériens peuvent bénéficier du RSA dès l’obtention de leur titre de séjour, sans avoir à justifier de cinq ans de résidence, comme le prévoit normalement le droit commun.
L’accès à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou minimum vieillesse, est également facilité. Les étrangers non-européens doivent généralement avoir résidé dix ans en France de manière régulière pour y prétendre. Cette exigence ne s’applique pas aux Algériens, qui doivent seulement résider neuf mois par an sur le territoire français l’année du versement.
En 2025, l’ASPA s’élève à 1 012,02 euros par mois pour une personne seule et à 1 571,16 euros pour un couple. Pour les personnes âgées d’origine algérienne, cet accès simplifié représente un soutien financier significatif.
Retraites françaises versées en Algérie
En 2023, 1,1 milliard d’euros de pensions du régime général ont été versés à 360 000 retraités vivant en Algérie, ce qui fait de ce pays le principal bénéficiaire de pensions françaises versées à l’étranger. Ces montants incluent des prestations versées à d’anciens travailleurs algériens ayant cotisé en France, mais également des compléments sociaux comme l’ASPA.
Selon un rapport parlementaire présenté le 15 octobre 2025, l’État algérien refuserait systématiquement de verser sa part des retraites dues à ses ressortissants ayant cotisé dans les deux pays, contrairement à ce que prévoit la convention bilatérale de sécurité sociale. Résultat : la France compense ce manque, en particulier via l’ASPA, transférant de fait la charge sur le contribuable français. Le député Charles Rodwell, co-auteur du rapport, dénonce un « déséquilibre structurel que la France assume seule depuis des années ».
Un coût global estimé à deux milliards d’euros par an
Le rapport Rodwell-Lefèvre évalue à environ deux milliards d’euros par an le coût global du régime dérogatoire accordé aux Algériens. Ce montant inclut :
– 300 millions d’euros de charges administratives et contentieuses,
– 1,5 à 2 milliards d’euros de dépenses sociales liées à une immigration plus familiale et moins insérée économiquement,
– Plusieurs centaines de millions d’euros de retraites et prestations versées à des résidents en Algérie.
Toutefois, les auteurs du rapport reconnaissent des limites méthodologiques : absence de données consolidées, difficulté à isoler les effets spécifiques de l’accord de 1968, impossibilité de calculer un solde net intégrant les contributions fiscales et économiques des Algériens en France. Des élus, comme Philippe Brun (PS), ont critiqué un document « politique plus que financier », soulignant l’absence de tableaux ou de données précises pour justifier les montants avancés.
Une immigration majoritairement familiale et concentrée
Au 31 décembre 2024, la France comptait 649 991 ressortissants algériens titulaires d’un titre de séjour valide. L’Algérie reste le premier pays d’origine des étrangers en situation régulière, représentant 16 % du total. En 2024, 29 100 premiers titres de séjour ont été délivrés à des Algériens, un chiffre en baisse de 9,1 % par rapport à l’année précédente. Plus de la moitié de ces titres (54,6 %) étaient liés à des motifs familiaux, contre seulement 9,4 % pour des motifs économiques.
Par ailleurs, les Algériens forment la première nationalité interpellée en situation irrégulière (33 700 personnes en 2024) et la première pour les renouvellements de titres de séjour (125 000 dossiers). Ces chiffres confortent l’analyse selon laquelle l’accord de 1968, pensé à l’origine pour l’immigration de travail, est devenu un vecteur d’immigration familiale.
Une crise diplomatique d’une ampleur inédite
Le vote du 30 octobre 2025 intervient dans un contexte de tensions exceptionnellement vives entre la France et l’Algérie. Des sources diplomatiques évoquent une crise sans équivalent depuis l’indépendance de 1962. Depuis plusieurs mois, les relations bilatérales se sont tendues autour de multiples sujets : visas, mémoire coloniale, coopération sécuritaire et commerciale. La remise en cause de l’accord de 1968, perçue à Alger comme une rupture unilatérale, aggrave un climat déjà délétère.
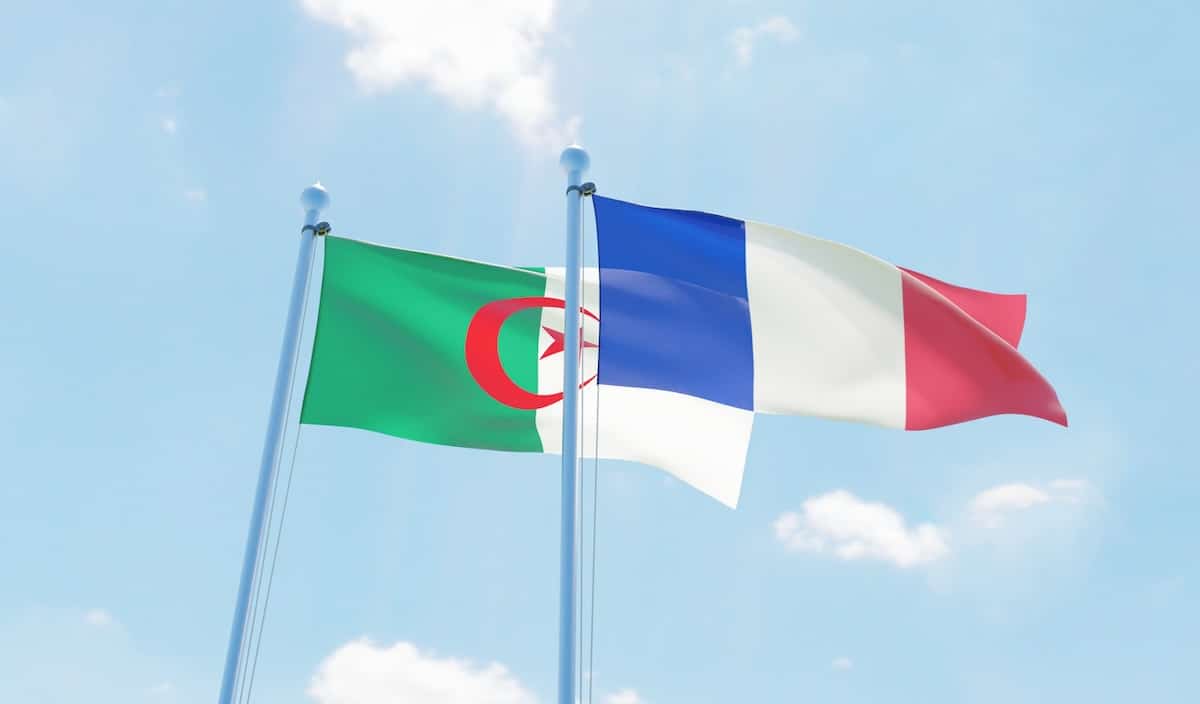


Les dirigeants de cette extrême droite revancharde tentent de faire croire à leurs partisans endoctrinés que les accords franco-algériens de 1968 demeurent particulièrement avantageux pour les Algériens. En réalité, ces fameux accords, que l’extrême droite brandit à chaque occasion comme un épouvantail destiné à flatter un électorat déjà conditionné par CNews et ses semblables, ont été profondément remaniés à deux reprises en 1985 et en 1994 dans un sens nettement restrictif. De ce fait, ils ne constituent aujourd’hui qu’une coquille vide.
Pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous un résumé des principales modifications apportées à ces accords.
les modifications de l’accord franco-algérien de 1968 intervenues en 1985, 1994 et 2001ont changé radicalement les conditions de séjour et de circulation des Algériens en France.
L’accord du 27 décembre 1968 était initialement très favorable aux Algériens, leur donnant un statut particulier, distinct du droit commun applicable aux autres étrangers.
Mais à partir des années 1980, la France a cherché à resserrer les conditions d’entrée et de séjour, tout en alignant progressivement le statut des Algériens sur celui des autres immigrés.
— Les modifications du 22 décembre 1985
Objectif :
Adapter l’accord à la nouvelle politique migratoire française (ralentissement de l’immigration de travail et montée du chômage).
Principales modifications :
1. Fin de la libre entrée pour le travail
Avant 1985, les Algériens pouvaient venir plus facilement travailler en France.
Après 1985, ils devaient obtenir une autorisation de travail avant leur arrivée.
2. Introduction de titres de séjour différenciés
L’accord de 1968 prévoyait des titres simplifiés.
En 1985, la France introduit des titres de séjour plus proches du droit commun (cartes de séjour d’un an, cartes de résident de 10 ans, etc.).
3. Durcissement du regroupement familial
De nouvelles conditions de logement et de ressources sont imposées.
Le regroupement familial devient moins automatique.
4. Contrôle accru à l’entrée
Obligation pour les Algériens d’obtenir un visa pour entrer en France, alors qu’avant, cela n’était pas toujours exigé.
Résultat :
Moins de liberté de circulation.
Début du rapprochement entre le régime “spécial” algérien et le droit commun français.
Les modifications du 11 juillet 1994
Contexte :
Montée du chômage et des tensions migratoires en France.
Contexte sécuritaire tendu en Algérie (début de la “décennie noire”).
Le gouvernement français veut renforcer le contrôle des flux migratoires.
Principales modifications :
1. Obligation de visa renforcée
Les Algériens doivent désormais obtenir un visa court séjour ou long séjour selon leur projet (études, travail, visite familiale, etc.).
2. Conditions de séjour plus strictes
Le renouvellement des titres de
vient plus encadré.
Le contrôle des ressources et de la stabilité du séjour est renforcé.
3. Limitation du regroupement familial
Application plus rigoureuse des critères de logement et de ressources.
Possibilité de refus pour “trouble à l’ordre public”.
4. Alignement sur le Code des étrangers français
Bien que l’accord de 1968 reste en vigueur, ses dispositions sont désormais interprétées à la lumière du droit français commun, limitant les privilèges initiaux.
En résumé
Période. Nature des modifications. Effet principal
1968 Accord très favorable : libre circulation, emploi facilité Statut privilégié pour les Algériens
1985 Première révision restrictive Fin de la libre entrée pour le travail, visas obligatoires
1994 Deuxième révision restrictive Contrôles renforcés, conditions de séjour durcies
Enfin, pendant que l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne et d’autres pays européens à l’instar de la grande Bretagne consolident leurs partenariats algériens, les députés du RN et leurs souteneurs eux, célèbrent bruyamment la marginalisation de la France.
À chacun sa stratégie : certains bâtissent des ponts, d’autres applaudissent les ruines
Urne honte!!!! En sachant en plus que les délinquants, les egorgeurs et les violeurs sont en majeure partie issue de cette populasse que le vrai Français nourrit.
Si votre journal se voulait véritablement neutre et impartial, il aurait accordé sa place à mon commentaire, lequel visait à éclairer certains aspects idéologiques entourant l’accord de 1968. Il semble toutefois que la conception de la liberté d’expression que vous défendez s’exerce dans les limites tracées par l’orientation éditoriale de votre rédaction.
Bonjour
Dans votre article vous affirmez selon votre tournure utilisée que l exigibilite au bénéfice de l aspa nécessite un séjour permanent régulier de 10 ans pour un étranger non européen non communautaire et 9 mois pour un ressortissant algérien ceci est complètement faux car l exigibilte de la durée de séjour est la même pour les algériens pour bénéficier de l aspa vous confondezl les conditions de séjour pour bénéficier de l aspa et la durée de séjour en France pour le maintien de la prestation qui est de 9 mois et qui est opposable à tout étranger non communautaire qu il soit algérien marocain ou autre pour le maintien de certaines prestations sociales dont l ASPA
L analyse sociale de cette convention doit faire appel à des experts confirmes et non à des idéologues en service commande
J’ai vécu en Asie pendant plusieurs années et où je m’y suis marié à une depuis 8 ans, suite à des raisons familiales et professionnelles, j’ai été contraint de retourner vivre en France. J’ai donc fait les démarches pour que mon épouse me rejoigne.
Donc des démarches compliquées, bien que mariés depuis plusieurs années et enregistré à l’Ambassade de France.
Elle a donc obtenu un visa VLS-TS d’un an, qu’il a fallu ensuite faire valider à son arrivée contre un timbre fiscal de 225€ (à savoir que les démarches et d’obtention du visa n’était pas non plus bon marché).
Elle a donc été ensuitee obligée d’effectuer la formation de langue française dispensée par l’OFII dont la prof était Algérienne, je n’airien contre sa nationalité, mais l’accent ne lui permettait pas de bien de se faire comprendre par rapport au mien auprès de mon épouse. Ensuite elle a dû suivre une formation civique pour une meilleure intégration. A savoir qu’elle n’e bénéficie d’aucune aide sociale (RSA), à part obtenir la carte vitale, pour la mutuelle j’ai dû lui en prendre une privée (environ 70€/mois).
A cette issue, elle a obtenu le niveau A1 et a pu ensuite effectuer sa demande de carte de séjour 3 mois avant l’expiration de son Visa. Vous n’imaginez même pas le nombre de documents demandés, de justificatif comme quoi elle vit bien avec moi… Allo ! on est marié depuis 8 ans, on est pas venu en France pour profiter du système. Elle a obtenue sa carte de séjour après 14 mois d’attente contre encore 225€ pour une validité de seulement 2 ans !
Le fait que durant cette longue attente, son visa avait expiré et donc comme elle n’était que sur des prolongations, ils ne lui était pas accordé de pouvoir rentrer en formation pour obtenir le niveau suivant de langue française, sans parler qu’il fallait qu’elle soit inscrite à France Travail où elle était radiée tous les 3 mois à chaque expiration de prolongation.
Bref, nous avons constaté, comme nous, que tous les couples franco-étranger de notre entourage ne bénéficiaient pas des même avantages pour le regroupement familiale et ont eu le même traitement.
Des couples d’amis de nationalité étrangères (Indiens, Pakistanais, Somaliens) et donc non des couples franco-étranger ont tous bénéficié de leur carte de séjour après seulement moins de 4 mois d’attente pour une durée de validité de de 5 à 10 ans contre un timbre fiscal à 75€ en plus de bénéficier de toutes les aides : RSA, APL, Logement social spacieux, sécurité sociale et la C2S.
Pour conclure, les couples franco-étrangers ne sont pas les bienvenus, n’ont pas droit aux aides sociales, ni au même type de carte de séjour et doivent payer le prix fort sans pouvoir en expliquer la raison de cette différence !
La France favorise donc plus les couples étrangers, les couples franco-étrangers ne sont donc pas les bienvenus pour je ne sais quelles raisons tout en étant fliqués, car oui, on nous demande toutes sortent de choses, par exemple après moins d’un an sur le territoir, ils souhaitaient savoir si on était parti à l’étranger récemment et pour combien de temps.
Allo ! On ne perçoit aucune aide, aucun avantage du système sociale français gratuitement comme la majorité des couples étrangers !
Pour être honnête, nous percevons cela comme une injustice ainsi que plusieurs autres couples de notre entourage qui ne sont d’ailleurs pas des personnes avec un revenu conséquent (plus proches du SMIC pour le seul et unique revenu que d’un revenu de 2000 € et plus par mois) pour comparaison, nos amis couples étrangers perçoivent bien plus, ce qui intérieurement renforce ce sentiment d’injustice sociale.
Je suis pour que toutes ses aides données si facilement soient supprimées et que je suis prêt à voter un extrême si cela peut tous nous remettre sur un pied d’égalité. Il n’y a aucune raison qu’un couple étranger qui ne soit pas dans les conditions de type « réfugié politique » bénéficie de tous les avantages possibles comparés aux couples franco-étranger qui ne sont pas plus fortunés.
bravo Fabien tout est juste sur ce que vous dites!
bonjour ,
dire que les algériens bénéficient de RAS a leur arrivée en France??? !!!!! c’est faux , ca fait 23 ans que je suis en France , je n’ai jamais touché le RSA, pareil pour mon épouse arrivée il y’a 14 ans ni RSA ni chaumage, c’est une femme au foyer elle touche rien de la part de l’état Français, donc il faut arrêter de nous raconté des salades .
Pour rappel, le salaire médian en Algérie, c’est 33500 dinars par mois (source : Wikipedia). soit 222 euros au cours officiel, et 121 euros au taux du marché noir (source : cours square de Port Said). le minimum vieillesse français, c’est 1000 euros par mois (source : servicepublic). Cette seule information croisée devrait permettre à n’importe qui de comprendre l’intérêt pour un algérien de percevoir le minimum retraite français : cette rente correspond, juste, à 9 fois le salaire médian du pays d’origine. Un algérien touchant 1000 euros par mois est un homme riche en Algérie…