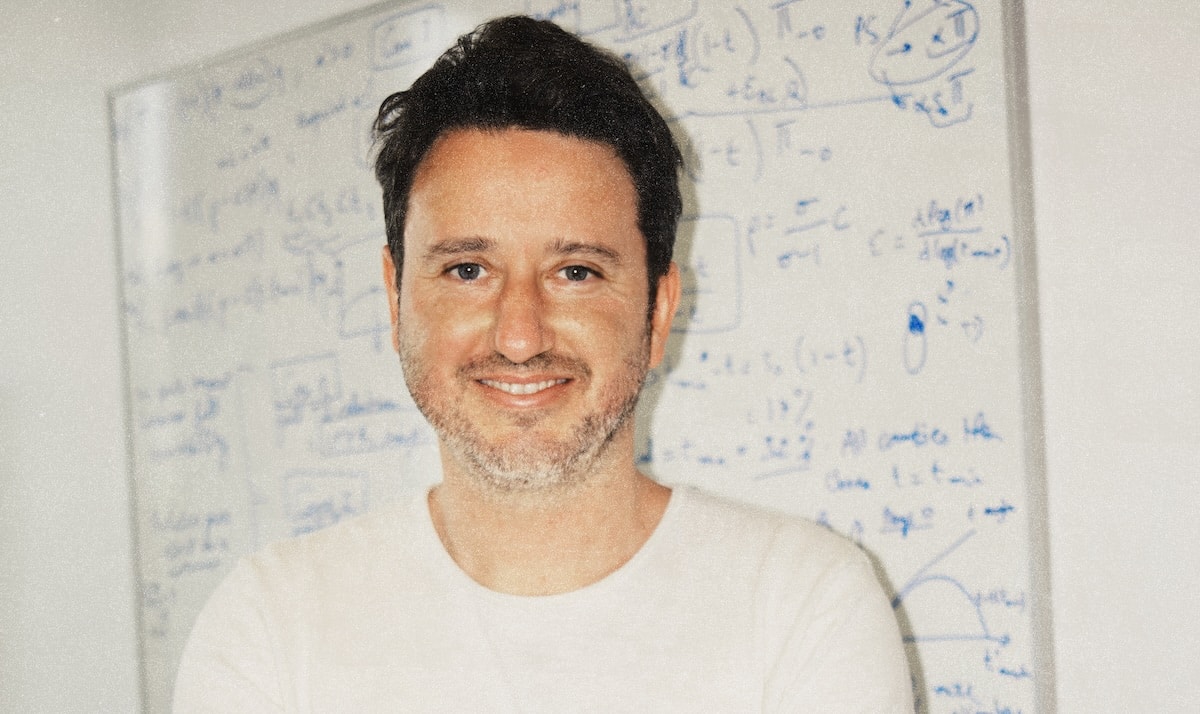Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Gabriel Zucman n’est pas un doux rêveur. À 38 ans, l’économiste français s’est hissé au sommet du débat fiscal mondial en posant une question simple : pourquoi les milliardaires paient-ils, en proportion, moins d’impôts que les classes moyennes ? Sa réponse est tout aussi limpide : instaurer un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine net des ultra-riches. Pas une usine à gaz de plus. Juste un seuil minimal, au-delà duquel on ne peut plus descendre.
A LIRE AUSSI
Macron et Lecornu ne veulent pas de la Taxe Zucman
Le cœur du raisonnement de Zucman est sans détour : l’impôt devient régressif tout en haut de l’échelle. En France, les milliardaires ne paient que 1,7 % de leur revenu en impôt sur le revenu. Aux Pays-Bas, c’est 0 %. Non pas grâce à la fraude, mais via un système parfaitement légal, qui repose sur deux piliers : ne pas toucher de dividendes (donc pas de revenu imposable) et loger sa fortune dans des holdings. Résultat : une richesse qui gonfle, mais qui reste fiscalement invisible.
Un impôt minimal, pas un impôt de plus
La proposition Zucman ne crée pas un nouvel impôt. Elle impose un taux effectif minimal de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Si un milliardaire paie déjà cela, il ne paie rien de plus. Sinon, il paie la différence. L’objectif est triple : refermer les échappatoires, rendre visible la richesse réelle, et garantir que même les plus riches contribuent au pot commun.
Zucman chiffre le rendement de cette mesure à 15 à 25 milliards d’euros par an pour l’État. Il a pour lui des soutiens de poids : plusieurs prix Nobel d’économie, dont Joseph Stiglitz, Esther Duflo ou Paul Krugman. Mais la critique n’est pas en reste. D’autres économistes, comme Antoine Lévy, ramènent le chiffre à 5 milliards, en invoquant l’évitement fiscal ou la fuite des capitaux. Des arguments qui s’appuient sur l’exemple de l’ISF – que Zucman juge hors sujet. Sa mesure inclut les biens professionnels et intègre un mécanisme d’exit tax : les contribuables qui quittent la France restent imposables pendant cinq ans.
A LIRE AUSSI
Taxe Zucman : justice fiscale ou risque économique ?
Start-ups et actionnariat : la faille
Mais la proposition heurte un autre nerf sensible : les start-up françaises. Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, estime ne pas pouvoir payer 234 millions d’euros en impôts liquides, sa fortune étant intégralement en actions. Zucman répond par une solution radicale : payer en actions. Ce qui ferait entrer l’État au capital. Les questions de gouvernance, d’indépendance et de distorsion de marché sont immédiates. Les socialistes proposent d’exclure les entreprises innovantes. Zucman refuse net. Pour lui, les exonérations sont le poison lent qui a tué l’ISF.
Un autre obstacle est juridique. En 2012, le Conseil constitutionnel a censuré un impôt supérieur à 1,8 % sans plafonnement en fonction des revenus. La taxe Zucman dépasse ce seuil… sans plafonnement. Des juristes pensent qu’elle ne passerait pas. D’autres, comme Jean-Philippe Derosier, estiment que son ciblage extrême et le contexte budgétaire pourraient justifier une exception. Zucman, lui, plaide l’égalité devant l’impôt. À ses yeux, taxer les ultra-riches à hauteur de leur capacité réelle, ce n’est pas confisquer. C’est réparer.
Une majorité de Français convaincue, des députés réticents
Dans l’opinion, la taxe Zucman fait un carton. Près de 80 % des Français y sont favorables, y compris dans l’électorat du Rassemblement national. Mais au Parlement, c’est un mur. Le 20 octobre, la commission des finances a rejeté la proposition, grâce à une alliance inattendue : macronistes, LR, UDI et RN ont voté contre. Le gouvernement a sorti une contre-proposition : taxer les holdings. Gain attendu : 1 à 1,5 milliard. Pour les soutiens de Zucman, c’est un coup de peinture sur une passoire.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu tente d’apaiser les tensions avec la gauche, qui menace de bloquer le budget sans mesure forte sur la justice fiscale. Mais l’examen de la taxe Zucman a été repoussé. La ministre Amélie de Montchalin invoque d’autres priorités. Pour la gauche, c’est clair : l’exécutif ne veut pas de ce débat.
L’ombre de l’ISF
Dans les esprits, la comparaison avec l’ISF est inévitable. Créé en 1981, vidé de sa substance par des niches, l’ISF finissait par frapper surtout les classes moyennes supérieures, tout en rapportant peu (4,2 milliards à sa suppression en 2017). Zucman affirme avoir tiré la leçon : pas de niches, pas d’exonération des biens professionnels, et un seuil très haut – 100 millions. Sa cible, ce sont les ultra-riches, rien d’autre.
La taxe Zucman n’est pas pensée pour rester dans les frontières. En Espagne, un impôt temporaire sur les grandes fortunes existe depuis 2023. Norvège et Suisse ont conservé des impôts sur la fortune. Mais aucun pays n’a mis en place un impôt plancher, avec inclusion des biens professionnels et exit tax. Selon un rapport remis au G20, une telle taxe appliquée à l’échelle européenne pourrait rapporter entre 67 et 121 milliards d’euros par an.