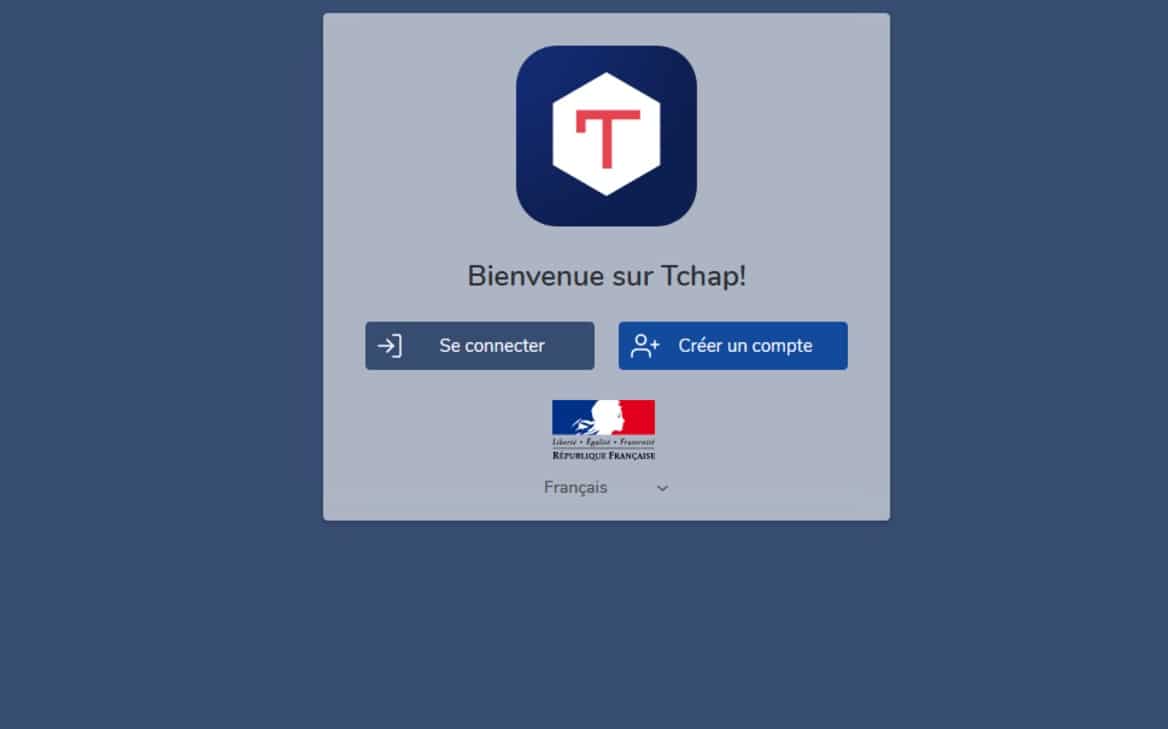À la rentrée, les ministres troqueront WhatsApp et Signal contre Tchap. Derrière ce changement d’apparence anodine, un enjeu bien plus vaste : la souveraineté numérique de l’État face aux géants étrangers du numérique et à une géopolitique de l’information de plus en plus tendue.
A LIRE AUSSI
Vous utilisez WhatsApp ? Voici ce que vous risquez
La consigne est claire. Dans une circulaire publiée fin juillet, le Premier ministre François Bayrou intime aux agents publics – ministères, préfectures, cabinets – de généraliser l’usage de Tchap. Objectif affiché : sécuriser les échanges sensibles et renforcer le contrôle national sur les infrastructures numériques utilisées par l’État. Une mesure de bon sens, dans un monde où une conversation mal chiffrée peut devenir une fuite diplomatique, une intrusion ou un levier d’influence.
Une application pas tout à fait née d’hier
Tchap n’est pas un gadget improvisé. Créée en 2019 par la DINUM (la direction interministérielle du numérique), l’application a connu des débuts chaotiques, avant de s’imposer discrètement dans les rouages administratifs, notamment lors du confinement. Début 2021, elle comptait déjà 200 000 utilisateurs. En 2025, ils sont plus de 300 000. Ce n’est pas encore l’application réflexe des agents publics, mais le mouvement est lancé.
L’interface rappelle celle des autres messageries instantanées – cryptage de bout en bout, usage multiplateforme. Sauf qu’ici, les serveurs sont français. Ce détail technique change tout. Car il signifie que les données ne sont pas accessibles aux lois extraterritoriales américaines ou aux caprices d’un fondateur russe.
Derrière Tchap, il y a un constat simple : les messageries grand public ne sont pas neutres. WhatsApp et Signal, pour ne citer qu’eux, sont régis par le droit américain. Avec le Cloud Act voté en 2018, Washington peut exiger les données d’une entreprise même si elles sont hébergées en Europe. Telegram, quant à lui, entretient une opacité technique et juridique qui agace autant qu’elle inquiète. L’arrestation à Paris de son fondateur Pavel Durov, en août 2024, en a rappelé les risques.
Résultat : les services de renseignement, comme l’ANSSI, multiplient les alertes. En 2017, l’ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas avait transmis une note confidentielle via Telegram.
Ironie de l’histoire : ce retour en grâce de Tchap signe aussi un désaveu à peine voilé d’un autre outil, Olvid, promu en 2023 comme la messagerie la plus sûre du monde. Las : si les échanges y sont cryptés, l’hébergement repose sur AWS, une filiale d’Amazon – et donc soumise, elle aussi, au Cloud Act. Un détail qui n’en est pas un.