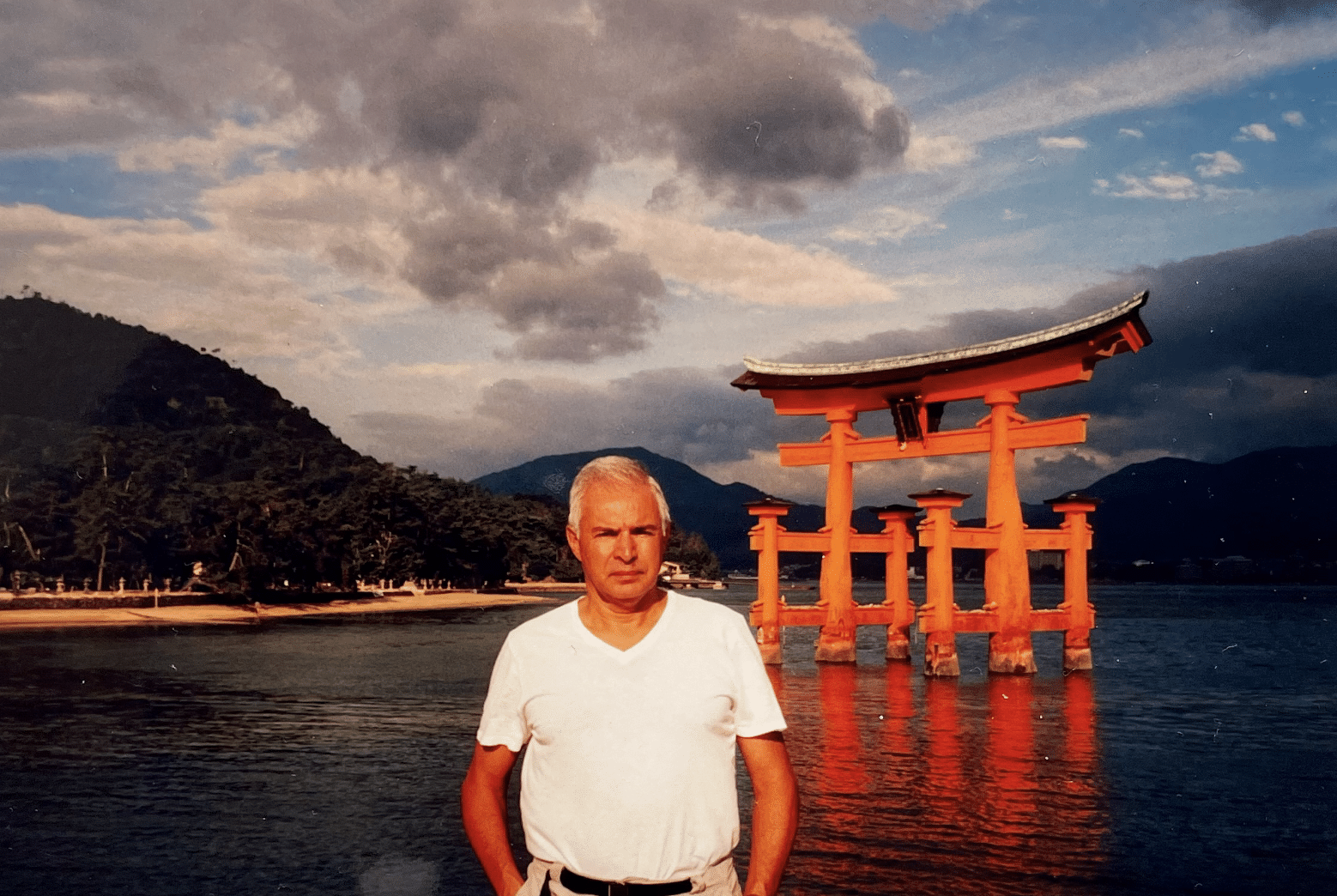Les commémorations se succèdent pourtant les unes après les autres, et ce sera en 2025 celle d’un 80ème anniversaire, celui d’une défaite collective au-delà du Japon; des hymnes à la paix rituels s’élèvent près du « dôme de Genbaku », bâtiment survivant de l’épicentre, devenu une cathédrale à ciel ouvert faite de quelques tiges d’acier. Mais une restitution de la tragédie, destinée à la conjurer, est-elle même possible ? Les témoignages au sol étant insoutenables, il s’agit le plus souvent d’une vue aérienne prise depuis l’avion chargé de la sinistre besogne ou d’un aéronef accompagnateur. L’explosion inconnue jusqu’alors ne fit pas de bruit à l’image, nous n’en ressentîmes pas le souffle dévastateur et encore moins le feu répandu au sol comme une faucille monstrueuse. L’avion s’appelait « Enola Gay », du nom de la mère du pilote, et la bombe à l’uranium 235 « Little boy ». Une mère et un fils: comment est-il imaginable qu’ils aient pu être les symboles de la mort dans des proportions jusqu’alors inimaginables ?
Il serait même vain d’avancer des explications rationnelles liées au phénomène de la guerre et à la stratégie ayant conduit à ce sinistre aboutissement. Alors que le 9 août 1945, jour de Nagasaki, les forces soviétiques pénétrèrent en Mandchourie, était-ce le prix à payer pour arrêter l’avancée déjà engagée de Staline en Extrême-Orient ? Eût-il été trop coûteux en hommes et interminable de poursuivre, avec de simples moyens conventionnels et îlot par îlot ? Un pays frappé et humilié était-il fondé à vouloir effacer le traumatisme de Pearl Harbor ? Briser une puissance impérialiste jusqu’alors inflexible en visant des populations civiles dans des dizaines de conurbations entières pouvait-il se poursuivre impunément ? La guerre totale changeait-elle d‘échelle de moyens ou plutôt de nature ? Tokyo n’avait-elle pas été largement réduite en flammes en mars de la même année à la suite du bombardement le plus meurtrier de la Seconde guerre mondiale ? N’y avait-il pas eu déjà les terribles punitions sur les villes allemandes à Hambourg dès juillet 1943 lors de l’opération « Gomorrhe » et surtout à Dresde en février 45 où une deuxième vague aérienne succédant rapidement à la première avait même ciblé les secours apportés aux victimes ? Un président, provincial, d’apparence terne, impopulaire, dont l’administration fut marquée par de nombreux scandales, entra cependant dans l’histoire où il devint une figure majeure de la guerre froide.
« Hiroshima, mon amour » peut être compris comme une expression chaotique de la mémoire, se traduisant par d’étranges monologues parallèles et un effort maladroit, car désespéré, d’envisager la réconciliation des peuples. Mais que reste-t-il d’Hiroshima dans l’imprégnation des esprits, sur le plan humain voire philosophique ? L’explosion n’est même plus identifiée, dans la conscience japonaise, à la puissance responsable, mais elle est jugée comme l’acte prométhéen suprême du feu dérobé aux Dieux, interdit jusqu’alors, commis par une humanité déterminée à anéantir la propre création qui la porte. Hiroshima, martyrisée, défigurée, c’est nous tous: « tu me tues, tu me fais du bien », doit-elle rester l’ultime et célèbre réplique ?
Patrick Pascal