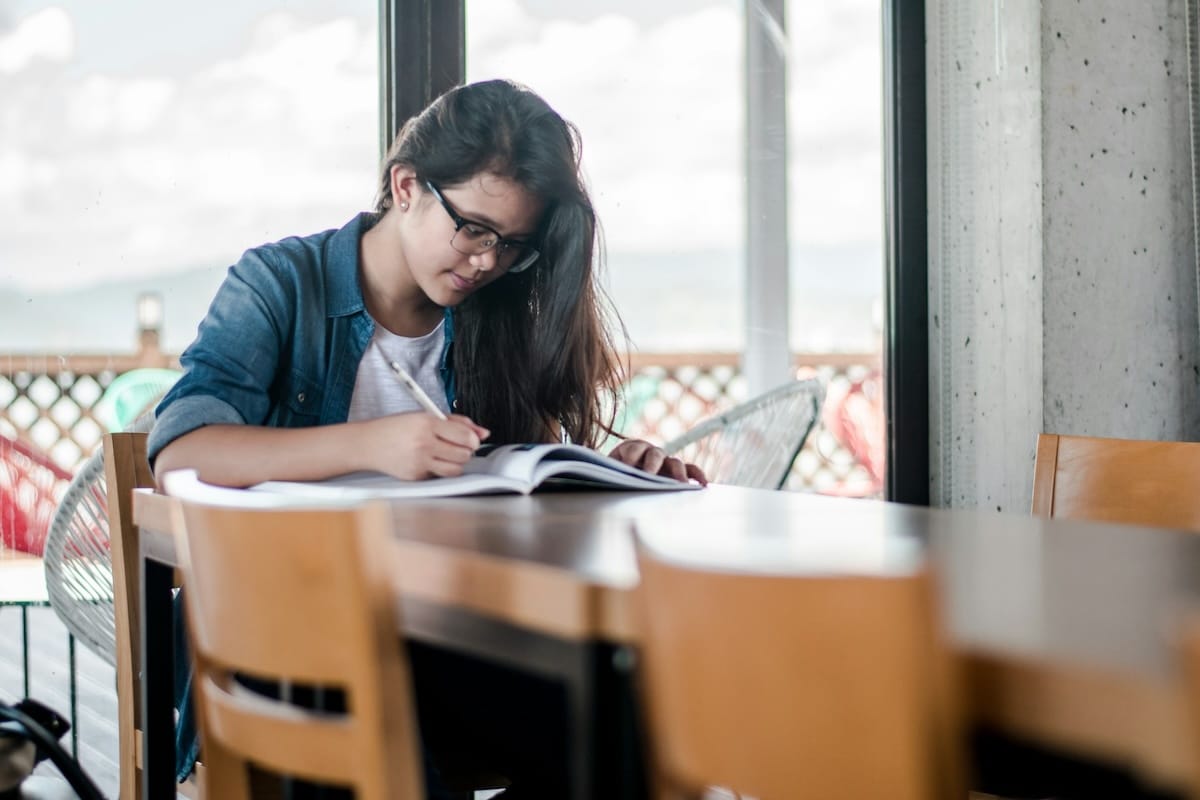Afficher le sommaire Masquer le sommaire
- Grand oral du bac : un format exigeant qui évolue
- Pourquoi commencer dès aujourd’hui ?
- Choisir ses questions : première étape stratégique
- S’entraîner à parler : la prise de parole comme compétence
- Préparer l’échange avec le jury : apprendre à penser en interaction
- Une préparation en cinq temps : calendrier conseillé
- Les techniques qui renforcent la performance
- Ressources pour bien se préparer
En juin 2026, près de 400 000 lycéens passeront le Grand oral, épreuve introduite lors de la réforme du baccalauréat en 2021. Avec un coefficient de 10 en voie générale et de 14 en voie technologique, cette épreuve reste l’une des plus déterminantes de l’examen jusqu’à la session 2026 incluse. À partir de 2027, son coefficient sera abaissé (8 et 12) pour faire place à une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques. Si l’enjeu reste fort, c’est la nature même de l’épreuve qui impose une préparation longue : au-delà des connaissances, le Grand oral évalue la parole, la pensée critique, la capacité à convaincre. Une compétence qui ne s’improvise pas.
A LIRE AUSSI
Les sujets du Bac français 2025
Grand oral du bac : un format exigeant qui évolue
L’épreuve se divise en trois temps : vingt minutes de préparation individuelle, dix minutes d’exposé sans notes rédigées, puis dix minutes d’échange avec le jury. Chaque candidat prépare en amont deux questions en lien avec ses enseignements de spécialité. Le jour de l’épreuve, le jury en choisit une.
Depuis 2024, le déroulé s’est précisé. L’élève présente sa réponse debout, de façon continue, en s’appuyant éventuellement sur un support visuel ou un tableau. Le second temps est un échange d’idées, d’approfondissements, d’arguments. La qualité de la prise de parole, l’articulation de la pensée, l’aisance relationnelle, la précision des connaissances et l’engagement personnel sont au cœur des critères d’évaluation.
Pourquoi commencer dès aujourd’hui ?
Préparer un oral de 10 minutes ne signifie pas simplement “répéter un discours”. Il s’agit d’élaborer une réflexion personnelle, structurée, en lien avec les programmes, tout en développant des compétences oratoires et relationnelles. Ces apprentissages sont progressifs. Les élèves qui s’y prennent tôt disposent d’un avantage net : le temps de mûrir, d’ajuster, de s’approprier pleinement leurs sujets.
Anticiper permet aussi d’éviter les erreurs fréquentes : choix de sujets trop vagues, mémorisation mécanique, gestion du stress négligée, posture inadaptée. Une préparation sur le long terme favorise la sérénité, la confiance et la performance.
Choisir ses questions : première étape stratégique
Le choix des deux questions constitue le socle de la préparation. Elles doivent être en lien avec les enseignements de spécialité, validées par les professeurs, et formulées de manière problématisée. Pour être efficaces, ces questions doivent répondre à plusieurs critères : clarté, faisabilité, originalité, ancrage disciplinaire et, surtout, intérêt personnel. Un sujet qui passionne suscite un engagement réel dans la durée.
Exemples : en SES, “Comment l’école reproduit-elle les inégalités sociales ?” ; en mathématiques, “Pourquoi les algorithmes de recommandation influencent-ils nos choix ?” ; en HGGSP, “La démocratie peut-elle survivre aux réseaux sociaux ?”. Une bonne question n’est pas une devinette ou une provocation. C’est une invitation à penser.
S’entraîner à parler : la prise de parole comme compétence
Parler en public, sans notes, de manière claire, convaincante, avec des mots justes et une posture adéquate, s’apprend. Dès février, les élèves doivent commencer les entraînements à l’oral. Présentations devant des camarades, enregistrements vidéo, simulations devant les professeurs ou les proches permettent de repérer les faiblesses : débit trop rapide, tics de langage, regard fuyant, discours désordonné.
Les exercices doivent viser la maîtrise de trois dimensions : la voix (volume, rythme, intonation), le corps (posture, gestuelle, regard), et la structuration du propos (introduction, développement, conclusion). Une parole construite et incarnée fait souvent la différence.
Préparer l’échange avec le jury : apprendre à penser en interaction
Les dix minutes d’échange sont souvent sous-estimées. Pourtant, elles permettent au jury d’évaluer la capacité du candidat à dialoguer, à argumenter, à réagir. Il ne s’agit pas d’un questionnaire mais d’un échange critique.
Pour s’y préparer, il est recommandé d’anticiper les questions possibles avec ses professeurs, de s’entraîner à reformuler une question, à reconnaître une impasse, à rebondir. Montrer sa capacité d’écoute, faire preuve de curiosité intellectuelle, assumer un point de vue personnel sont des marqueurs positifs.
Une préparation en cinq temps : calendrier conseillé
Une bonne préparation s’organise tout au long de l’année de terminale.
- Octobre : se familiariser avec l’épreuve, lire les textes officiels, identifier les spécialités porteuses.
- Novembre-décembre : formuler des pistes de questions, entamer des recherches préliminaires, en discuter avec les enseignants.
- Janvier : faire valider les questions, approfondir les axes d’argumentation.
- Février-avril : structurer le propos, construire un plan, commencer les entraînements à l’oral.
- Mai-juin : intensifier les simulations, travailler les interactions, gérer le stress.
Les techniques qui renforcent la performance
Maîtriser l’oral, c’est aussi maîtriser son stress. Des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque (inspiration 4s, expiration 6s) ou la méthode 4-7-8 peuvent être intégrées à la routine. La visualisation mentale — se projeter en situation de réussite — améliore la concentration et diminue l’anxiété. Un bon sommeil, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée renforcent les capacités cognitives.
L’oral se joue aussi dans les détails : une posture droite, un regard franc, une gestuelle ouverte, une tenue appropriée contribuent à transmettre de la confiance au jury.
Ressources pour bien se préparer
De nombreuses ressources gratuites sont disponibles en ligne. La plateforme prepagrandoraldubac.fr propose des vidéos pédagogiques thématiques. Lumni offre des conseils pratiques animés par des professionnels du théâtre. Les chaînes YouTube éducatives (Les Bons Profs, Bright Future, SuperBac) complètent l’offre.
En classe, les professeurs de spécialité accompagnent les élèves dans la formulation des questions, la construction de l’argumentation et les entraînements. Certains établissements proposent des oraux blancs. Des organismes privés organisent aussi des stages intensifs, individuels ou collectifs, sur plusieurs jours.