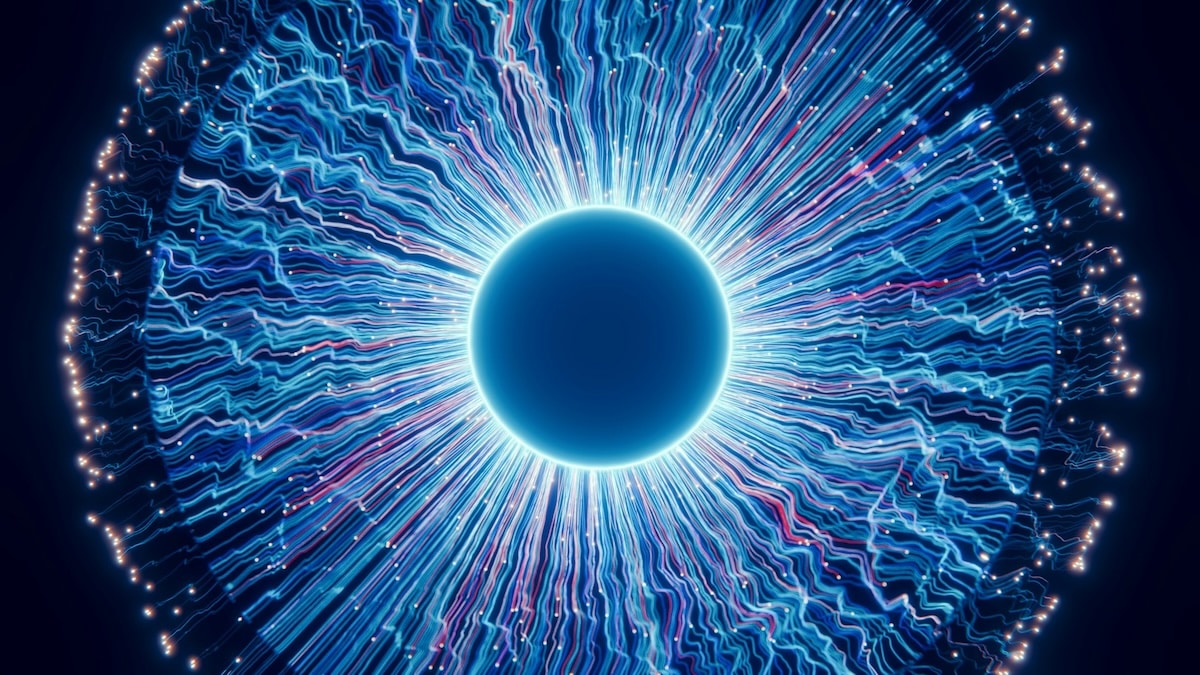Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Prophesee, startup française spécialisée dans la vision artificielle, a vu son destin basculer en 2021 avec l’entrée remarquée du fonds d’investissement de la CIA à son capital. Une prise de participation révélatric. e de l’intérêt croissant des grandes puissances pour les technologies de rupture issues de la recherche française. À la croisée des chemins entre science, industrie et renseignement, lProphesee met en lumière les failles de la souveraineté technologique nationale face aux ambitions américaines.
Une technologie née de la recherche publique française
Fondée en 2014 au sein du startup studio iBionext, Prophesee est le fruit de quinze années de recherche fondamentale sur la vision humaine, menée par l’Institut de la Vision (CNRS, UPMC, INSERM). À l’origine, l’entreprise – alors baptisée Chronocam – ambitionne de restaurer la vue des malvoyants à l’aide d’une rétine artificielle mimant le fonctionnement biologique de l’œil.
A LIRE AUSSI
Bertrand Rondepierre, l’inconnu qui dirige l’IA militaire française
Sa technologie repose sur le principe de la vision par événement : au lieu de capter une image complète à intervalles réguliers, le capteur réagit uniquement aux variations de lumière ou de mouvement. Cette approche, inspirée du fonctionnement du nerf optique, permet de traiter l’information en temps réel avec une consommation énergétique minimale. D’abord orientée vers la santé, la startup pivote rapidement vers les secteurs industriel et militaire, en raison des difficultés liées à l’implantation chirurgicale de ses dispositifs.
L’entrée stratégique d’In-Q-Tel, le fonds de la CIA
En octobre 2021, In-Q-Tel, le fonds d’investissement affilié à la CIA, entre au capital de Prophesee. Montant engagé : environ 200 000 euros. Une somme modeste, mais qui donne au fonds américain un siège d’observateur au conseil d’administration. Ce statut permet un accès privilégié aux orientations stratégiques de l’entreprise, sans participation directe aux votes.
Créé en 1999, In-Q-Tel agit comme un outil d’intelligence technologique pour le compte des agences de renseignement américaines. Son objectif n’est pas la rentabilité mais l’identification des technologies critiques pouvant servir les intérêts sécuritaires des États-Unis. Depuis 2018, le fonds a renforcé sa présence internationale avec des antennes à Londres, Munich, Sydney et Singapour, témoignant d’une stratégie offensive vis-à-vis des écosystèmes technologiques étrangers.
L’investissement dans Prophesee constitue son premier mouvement public en France, à travers une technologie aux usages potentiellement décisifs pour la détection automatisée de drones, la surveillance et la reconnaissance en environnements hostiles.
A LIRE AUSSI
Drones Kamikazes : Thalès frappe un grand coup
Une startup française au cœur des tensions géopolitiques
Prophesee évolue dans un environnement capitalistique complexe. Outre In-Q-Tel, plusieurs investisseurs chinois figurent à son capital, dont Xiaomi et Sinovation Ventures. En 2024, un report de contrat stratégique dans le secteur du mobile en Chine a précipité l’interruption d’une levée de fonds, entraînant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Parallèlement, les relations avec Sony – fournisseur historique de capteurs – avaient jusqu’alors empêché Prophesee de s’orienter vers les marchés de la défense. Ce verrou a sauté début 2024, permettant à l’entreprise de collaborer avec STMicroelectronics. Aujourd’hui, 30 % du chiffre d’affaires de Prophesee provient de projets liés à la défense, avec une dizaine de contrats de pré-développement en cours.
Le tour de table de l’entreprise témoigne de son attractivité mais aussi de la pression géopolitique qu’elle subit : investisseurs américains, chinois, saoudiens (via Aramco) et européens (BEI, Bpifrance) se côtoient dans une configuration où chaque engagement financier peut devenir un levier d’influence stratégique.
Des failles françaises dans la protection des technologies critiques
L’affaire Prophesee met en lumière la vulnérabilité de l’écosystème deeptech français face aux stratégies de captation étrangères. Issue de la recherche publique, soutenue par des fonds européens et nationaux, la startup n’a pourtant pas été protégée d’une pénétration américaine dans un secteur à haute valeur stratégique.
Si la France dispose de dispositifs de contrôle des investissements étrangers, leur mise en œuvre reste souvent réactive et parcellaire, notamment dans les secteurs émergents où les usages civils et militaires se confondent. La technologie de vision neuromorphique, bien que non classée comme sensible au moment de l’investissement d’In-Q-Tel, présente des applications duales évidentes, comme l’a montré la guerre en Ukraine avec le rôle des capteurs dans la détection autonome de drones.
La trajectoire de Prophesee interroge également le rôle des soutiens publics. En 2024, Bpifrance a débloqué 15 millions d’euros pour le financement d’une nouvelle génération de capteurs à travers le plan France 2030. Mais cette aide arrive alors que l’entreprise entame un redressement judiciaire, signe que l’accompagnement institutionnel n’a pas suffi à sécuriser sa croissance dans un contexte de compétition mondiale exacerbée.