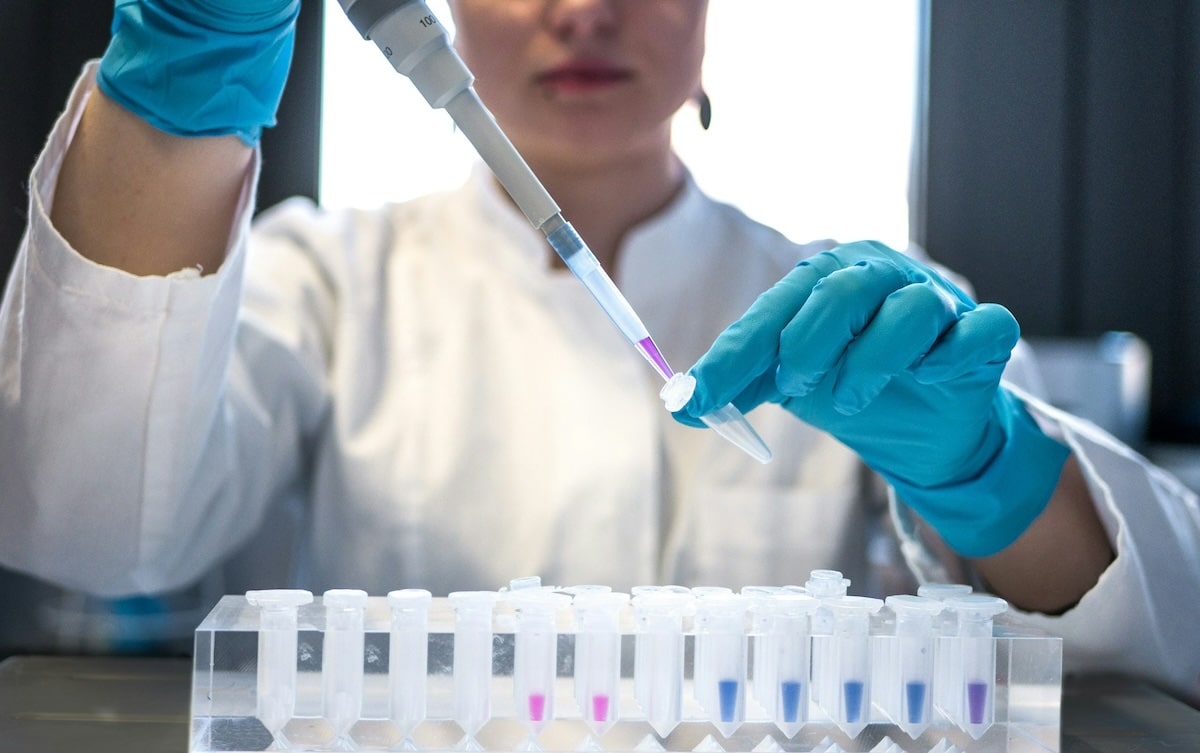Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Installé depuis 2015 au sein du Biodistrict de Gerland, Bioaster s’apprête à cesser définitivement ses activités. Le conseil d’administration de l’institut a voté sa fermeture début juillet, à la suite de l’annonce par l’État de l’arrêt de son financement. Près de 91 salariés, dont environ 80 chercheurs selon les sources, sont concernés par un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) en cours de déploiement entraînant leur licenciement.
A LIRE AUSSI
SeqOne : l’ambition mondiale d’une biotech de Montpellier
Ce départ marque un coup dur pour l’écosystème scientifique lyonnais. Le Biodistrict de Gerland concentre plus de 5 000 emplois et 2 750 chercheurs, et constitue le principal pôle français en sciences de la vie. Avec Bioaster, c’est l’un de ses piliers les plus emblématiques qui disparaît.
Un modèle public-privé fragilisé dès sa création
Créé en 2012 dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, Bioaster reposait sur un modèle inédit. Unique IRT (Institut de recherche technologique) français dédié à la santé, il résultait d’un rapprochement entre l’Institut Pasteur et Lyonbiopôle.
L’objectif : développer des technologies innovantes en lien direct avec les industriels. Cette Fondation de Coopération Scientifique s’est implantée dans un bâtiment de 3 800 m² à Lyon, avec des laboratoires P2 et P3 de dernière génération, et des partenariats institutionnels structurants avec l’INSERM, les CHU, ou encore le laboratoire P4 Jean Mérieux.
A LIRE AUSSI
Nabla, l’IA française que les médecins américains s’arrachent
Un institut reconnu, un bilan scientifique solide
En treize ans, Bioaster a conduit plus de 400 projets de recherche collaboratifs. Il comptait plus de 100 entreprises partenaires et une cinquantaine de laboratoires académiques associés. L’institut a déposé 27 brevets et attiré des chercheurs venus de 17 nationalités différentes, avec une politique de recrutement favorisant la mixité et l’expertise.
Ses travaux se concentraient sur quatre axes : les vaccins, les antimicrobiens, le microbiote et le diagnostic. L’institut a notamment joué un rôle actif dans plusieurs projets européens, illustrant sa capacité à se positionner à l’échelle internationale.
Bioaster fonctionnait selon un principe de cofinancement entre l’État et les industriels fondateurs. Ce modèle hybride, pensé pour mutualiser les risques de l’innovation, s’est révélé vulnérable aux cycles économiques. Dès 2020, une évaluation du Hcéres pointait la fragilité structurelle de son modèle économique.
Les contributions des industriels étaient limitées aux projets les impliquant directement. En parallèle, les revenus tirés des prestations ou services restaient insuffisants pour compenser le retrait progressif du soutien public. L’institut dépendait fortement des subventions publiques pour son fonctionnement, avec un budget annuel oscillant entre 15 et 20 millions d’euros.
L’État mise sur un nouveau biocluster controversé
En mai 2025, l’État a annoncé l’arrêt définitif de son financement. Les industriels fondateurs – Sanofi, bioMérieux, Boehringer-Ingelheim, Danone – ont immédiatement indiqué qu’ils ne se réengageraient pas. Faute de ressources, la direction de Bioaster a acté la fermeture en juillet.
Le gouvernement a justifié sa décision en estimant que l’État avait rempli son rôle de soutien. Une position jugée incohérente au regard des promesses affichées ces dernières années sur le renforcement de la recherche publique et la souveraineté sanitaire. La décision a été prise sans étude de transition ni mécanisme de sauvegarde, provoquant un choc dans la communauté scientifique.
En parallèle, l’État a officialisé à l’été 2024 la création d’un nouveau Biocluster pour l’Innovation en Maladies Infectieuses (BCF2I), dans le cadre de France 2030, doté de 60 millions d’euros sur cinq ans. Ce nouveau dispositif, porté par Lyonbiopôle, associe les mêmes industriels que Bioaster, sur les mêmes thématiques.
Contrairement à Bioaster, le biocluster n’est pas un institut doté d’équipements ni d’équipes permanentes. Il vise à structurer un réseau de projets collaboratifs, sans reprendre les infrastructures ni les personnels existants. Une décision perçue comme une duplication coûteuse plutôt qu’une consolidation stratégique.
Conséquences durables pour la recherche française
La fermeture de Bioaster provoque une dispersion rapide des compétences. Les 91 salariés concernés, dont une majorité de scientifiques, sont placés en PSE sans solution de réintégration. L’expertise développée sur plus d’une décennie, notamment dans la lutte contre l’antibiorésistance, sera perdue.
Cette situation intervient alors que les menaces sanitaires globales s’intensifient. Bioaster avait contribué activement à la réponse à la pandémie de COVID-19, avec des projets européens majeurs, comme COVID-AuRA Translate. Son rôle dans la recherche sur les thérapies antimicrobiennes était reconnu à l’échelle européenne, notamment via des partenariats comme INCATE.
La gestion de la fermeture soulève des critiques sur la gouvernance de l’innovation en France. L’arrivée en avril 2025 d’un nouveau directeur général, Alexandre Moulin, n’a pas suffi à enrayer le processus. La décision était déjà actée, et aucune alternative de relance n’a été sérieusement envisagée.
Le manque de coordination entre les différents acteurs publics – ministères, agences, opérateurs – a renforcé la perception d’un abandon politique. Dans un contexte où la souveraineté technologique devient une priorité stratégique, la fermeture d’un institut opérationnel sans plan de reprise interroge sur la cohérence des choix gouvernementaux.
Instabilité chronique
L’affaire Bioaster illustre plus largement les limites du système français d’innovation. L’État a investi 120 millions d’euros dans l’institut depuis sa création, avant d’injecter 60 millions supplémentaires dans une structure concurrente. Cette succession de dispositifs sans vision à long terme nourrit une instabilité chronique. Contrairement à l’Allemagne, où les instituts Fraunhofer bénéficient de financements pérennes et d’une gouvernance consolidée, la France peine à faire émerger une culture de l’évaluation et de l’adaptation. Plutôt que de corriger les failles d’un modèle prometteur, les autorités préfèrent repartir de zéro.
La disparition de Bioaster intervient alors que la France affirme vouloir renforcer ses capacités en biotechnologies et en recherche en santé. Ce démantèlement affaiblit la position française face à la concurrence américaine, chinoise ou suisse, qui investissent massivement dans des écosystèmes stables et continus.
La fermeture de l’unique IRT santé envoie un signal négatif aux chercheurs, aux industriels et aux partenaires européens. Elle prive le pays d’un outil stratégique dans un secteur où la constance et la durée sont essentielles. Le savoir-faire accumulé sera disséminé, et les talents risquent de rejoindre d’autres structures, souvent à l’étranger.
Au-delà de Bioaster, c’est l’ensemble du Biodistrict lyonnais qui est fragilisé. Avec la disparition de cet acteur-clé, la dynamique de recherche en microbiologie perd un moteur structurant. Le tissu d’innovations construit depuis plus de dix ans s’effiloche, faute de relais efficaces.
La France avait là un outil opérationnel, reconnu, et capable d’accompagner les grandes transitions sanitaires. Elle choisit de le démanteler sans alternative crédible. Une décision aux conséquences durables, à l’heure où la souveraineté technologique et la résilience sanitaire sont des enjeux cruciaux.