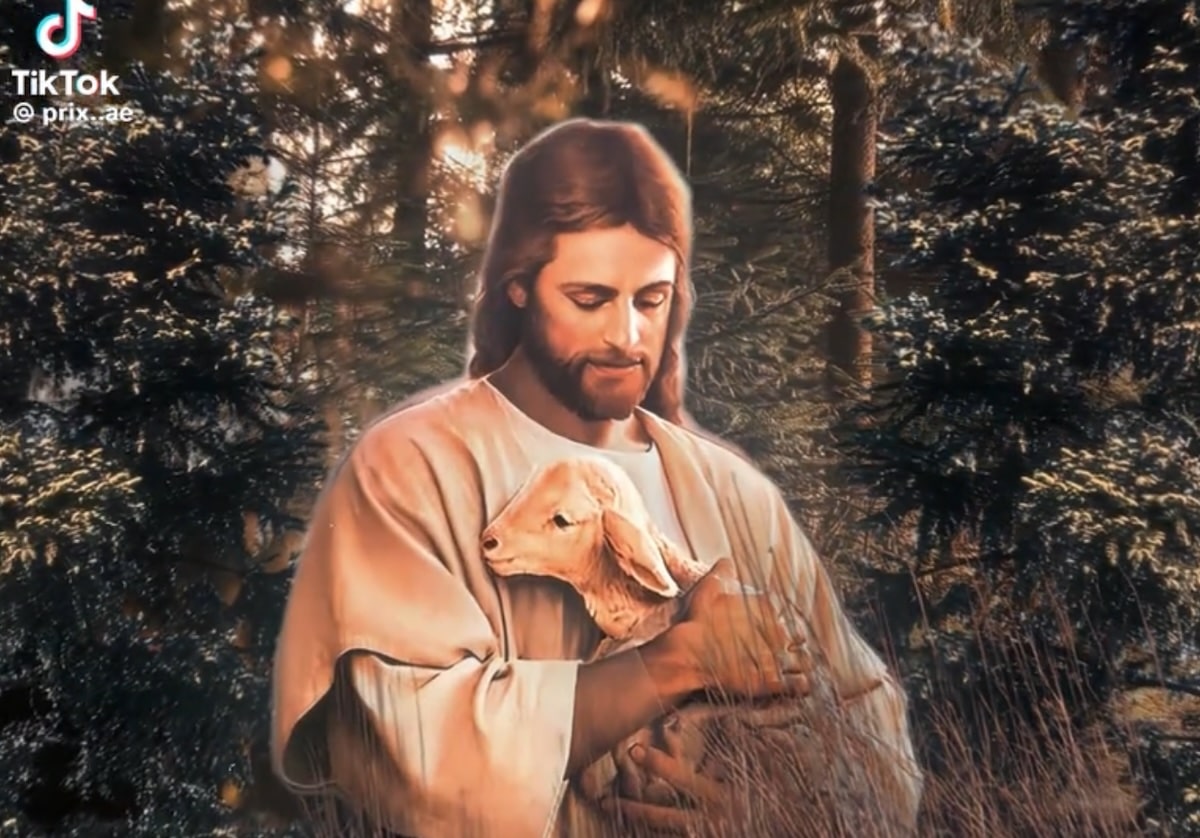Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Sur TikTok, la Vierge Marie filme son accouchement comme une influenceuse et Jésus mange du poulet frit, les bras musclés, dans une mise en scène digne d’un jeu vidéo. Ces vidéos, générées automatiquement par des outils d’intelligence artificielle, réinterprètent les récits bibliques à travers des formats absurdes, esthétiquement enfantins, souvent déconcertants. En quelques semaines, certaines atteignent des millions de vues. Ce phénomène, à la fois culturel, économique et éthique, interroge le statut du religieux dans l’ère numérique.
Quand l’intelligence artificielle s’empare des récits bibliques
Les vidéos TikTok mêlent des images de synthèse, des voix robotiques – parfois masculines, parfois féminines – et une mise en scène éclatée, où les personnages bibliques évoluent dans des contextes totalement déconnectés du texte d’origine. La narration ignore souvent la chronologie, les relations entre les personnages ou le sens des événements. Dans certains cas, des figures contemporaines, comme des célébrités récemment disparues, apparaissent aux côtés de Jésus ou de Marie.
L’esthétique visuelle évoque les dessins animés pour enfants, tandis que les dialogues sont simplistes, répétitifs ou incohérents. Ce contenu, produit en quelques minutes à l’aide de générateurs d’images, de voix et de scripts automatisés, s’inscrit dans une tendance plus large connue sous le nom de AI slop : des vidéos sans valeur informative, générées à bas coût et destinées à capter l’attention algorithmique.
A LIRE AUSSI
Instagram : la publicité déguisée trompe les utilisateurs
Des vidéos virales qui brouillent le message religieux
Ces contenus reposent sur une logique de consommation rapide, privilégiant l’impact visuel à la cohérence ou à la transmission fidèle. Le message religieux est réduit à des scènes spectaculaires ou sentimentales, où la profondeur spirituelle cède la place à l’émotion immédiate. La structure même des récits est souvent vidée de sa complexité, rendant impossible toute compréhension du contexte historique, théologique ou culturel.
Cette simplification expose à des dérives : les textes sont sélectionnés, recomposés ou tronqués en fonction de leur potentiel viral. Ce traitement algorithmique du sacré brouille la frontière entre message religieux et contenu de divertissement, au risque d’affaiblir la portée symbolique des figures représentées.
La diffusion massive de ces vidéos dans des formats courts, répétitifs et détachés de tout ancrage institutionnel transforme la religion en produit jetable, soumis aux mêmes logiques que n’importe quel contenu viral.
A LIRE AUSSI
Comment Visibrain révolutionne l’analyse des réseaux sociaux
Une économie algorithmique au service de la foi numérisée
Derrière ces productions se développe un écosystème économique bien rôdé. Sur YouTube, certaines chaînes atteignent plusieurs millions de vues en publiant quotidiennement des vidéos bibliques générées par IA. Des créateurs diffusent des tutoriels expliquant comment automatiser la production de contenu religieux afin d’en tirer des revenus publicitaires. Les formats longs, en particulier ceux diffusés en anglais, sont privilégiés pour leur rentabilité.
Le contenu religieux devient ainsi une niche parmi d’autres sur les plateformes, exploitée comme levier de croissance dans l’économie de l’attention. L’apparente gratuité de ces vidéos masque un modèle fondé sur la captation des clics, l’optimisation algorithmique et la monétisation systématique de la foi numérisée.
Cette marchandisation crée une tension forte entre le désir de partage spirituel et l’impératif de performance économique. Les vidéos sont conçues pour répondre aux logiques des plateformes, non pour transmettre un enseignement cohérent.
Spiritualité digitale : entre réconfort et perte de repères
Malgré leur caractère artificiel, ces vidéos rencontrent un véritable écho auprès d’une partie du public. Dans les commentaires, les réactions sont nombreuses, souvent marquées par une foi sincère. Messages de gratitude, expressions de foi ou témoignages personnels s’accumulent sous les publications. Pour certains utilisateurs, ces contenus offrent un soutien moral, une forme de consolation ou une réponse à une quête intérieure.
Ce phénomène traduit un déplacement du religieux vers les espaces numériques, à une époque où les repères traditionnels s’érodent. Les réseaux sociaux deviennent un lieu d’expression de la foi, mais aussi un lieu de consommation spirituelle, où la rapidité et la facilité d’accès priment sur la réflexion ou la médiation.
La forme même du contenu — animé, court, émotionnel — répond à une demande de simplicité. Ce besoin n’est pas en soi problématique, mais il pose la question du rôle des institutions culturelles et religieuses face à des récits transformés en objets numériques désacralisés.
L’irruption de l’intelligence artificielle dans la production de contenus religieux soulève une question centrale : que reste-t-il de la religion lorsqu’elle est entièrement façonnée par des algorithmes ? Ces vidéos fragmentent le message, en réduisent la portée, et favorisent une consommation où le sens est sacrifié à la forme.
Le résultat est un contenu spectaculaire, accessible et attrayant, mais souvent creux. La parole biblique, autrefois transmise par des figures de médiation (enseignants, prêtres, éducateurs), devient ici un matériau brut, manipulé, recomposé, distribué sans filtre. Ce changement de régime fragilise l’expérience religieuse elle-même, qui suppose du temps, du lien, et une certaine densité symbolique.
Sans cadre critique ni accompagnement, ce contenu diffusé à grande échelle contribue à une confusion entre divertissement, information et spiritualité.
Un défi éthique face à la puissance des technologies
L’absence de régulation dans la production de ces vidéos soulève de nombreuses interrogations : qui décide de ce qui est partagé ? Quelle légitimité pour des contenus générés automatiquement, sans regard humain ? Quelle place reste-t-il pour la vérité, la nuance, la transmission culturelle dans ce flux continu de messages altérés ?
À mesure que la technologie pénètre les sphères les plus intimes, dont celle du sacré, la nécessité d’un débat public se fait plus pressante. Car si l’algorithme peut divertir, il peut aussi dénaturer. Et lorsqu’il s’empare de la foi, c’est toute une mémoire symbolique qu’il risque d’effacer.