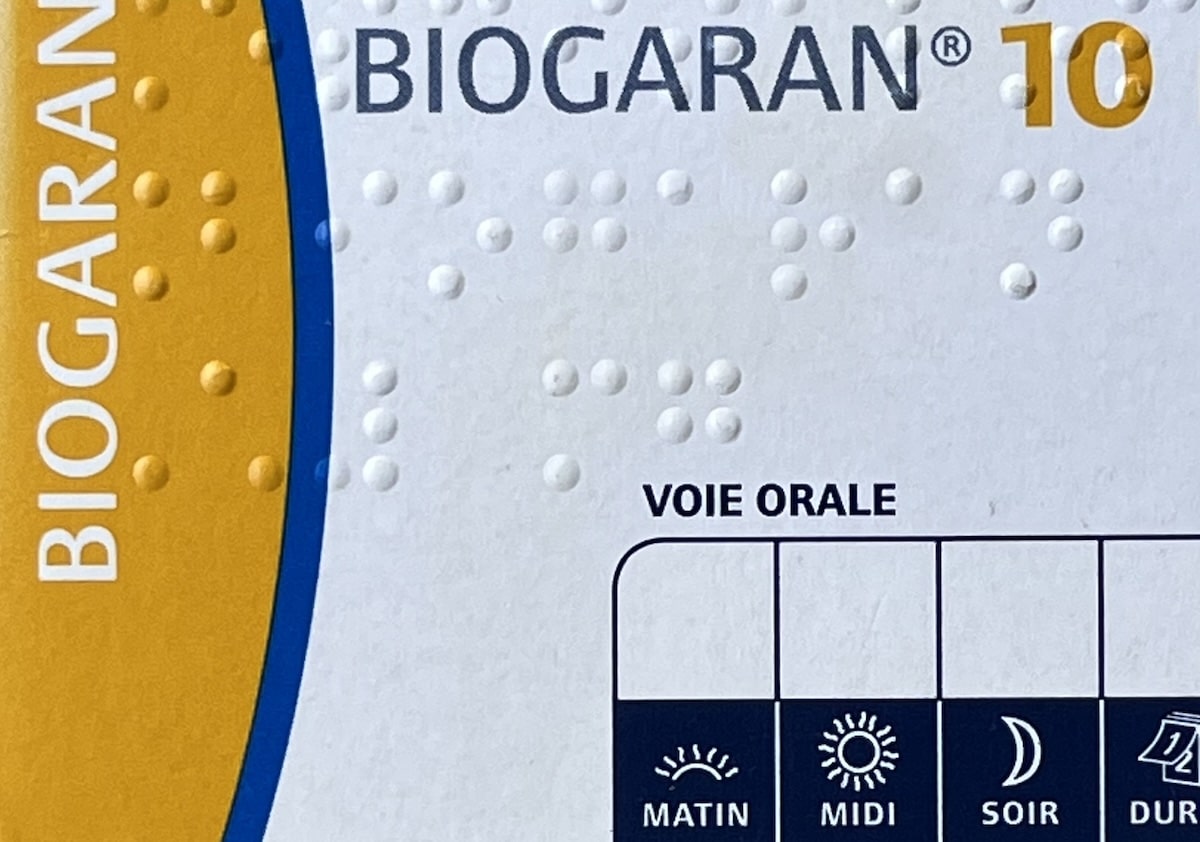Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Le laboratoire Servier a annoncé l’ouverture de négociations exclusives avec BC Partners pour la vente de sa filiale Biogaran, champion français du médicament générique. Une décision stratégique qui, une fois encore, ravive les inquiétudes sur la capacité de la France à préserver sa souveraineté sanitaire. Car Biogaran, c’est plus de 30 % des ventes de génériques dans l’Hexagone.
A LIRE AUSSI
Xanax, alerte sur une addiction française
Servier relance la vente de Biogaran malgré les tensions politiques
Un an après avoir suspendu un premier projet de cession, Servier change de cap. Le 30 juillet, le laboratoire a officialisé des négociations exclusives avec le fonds britannique BC Partners pour céder Biogaran. Cette opération avait déjà été envisagée à l’été 2024, mais avait été gelée face à une forte réaction politique et médiatique. Aujourd’hui, elle refait surface, dans un contexte où les appels à la relocalisation industrielle n’ont jamais été aussi pressants.
Avec cette annonce, c’est une nouvelle fois la question fondamentale qui ressurgit : la France a-t-elle encore les moyens de contrôler les leviers stratégiques de son système de santé ?
Créée en 1996, Biogaran est devenue en moins de trente ans un acteur incontournable du générique français. Avec plus de 1 000 références au catalogue, 300 millions de boîtes vendues chaque année, et 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise représente une boîte de médicament sur huit consommée en France. Elle repose sur un réseau de quarante sous-traitants répartis dans le pays, générant environ 8 000 emplois indirects, malgré ses 240 salariés en interne.
Maillon clé de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique
Cette intégration territoriale fait de Biogaran un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique française. Une entreprise “made in France” qui cristallise désormais les enjeux d’indépendance sanitaire.
BC Partners, fonds d’investissement basé au Royaume-Uni, n’est pas novice dans l’industrie pharmaceutique. Il détient déjà des sociétés comme Pharmathen, Aenova ou encore Synthon, spécialiste des génériques complexes. Le montant de l’opération pourrait approcher le milliard d’euros.
Déjà présent dans les négociations en 2024, BC Partners pourrait cette fois s’associer de nouveau à Bpifrance, la banque publique d’investissement française, qui prendrait une part minoritaire. Une configuration qui, bien que rassurante à première vue, ne suffit pas à éteindre les doutes sur l’avenir industriel du site.
BC Partners affirme vouloir maintenir le siège de Biogaran en France et conserver l’essentiel de la production sur le territoire national. À ce jour, 51 % des médicaments Biogaran sont produits en France, et 90 % en Europe. Mais ces promesses font écho à celles formulées lors du premier projet de cession, déjà critiquées pour leur manque de garanties.
Souveraineté pharmaceutique
Le ministère de l’Économie suit le dossier de près. Une source proche de Bercy indique que le gouvernement veille à la préservation des engagements industriels et à la continuité de l’approvisionnement pharmaceutique. La discrétion est de mise, mais la vigilance est réelle.
Une participation minoritaire de Bpifrance pourrait offrir un levier de contrôle sans entraver la stratégie de recentrage de Servier. Ce dernier cherche à se concentrer sur ses activités de recherche et sur des domaines thérapeutiques ciblés.
L’affaire Biogaran ne se limite pas à un simple transfert de propriété. Elle révèle une fois de plus les limites de la stratégie industrielle française en matière de santé. Depuis la crise du Covid-19, les discours sur la relocalisation et la souveraineté n’ont cessé de se multiplier. Mais la réalité semble suivre un chemin inverse, avec la cession d’un acteur structurant de la chaîne du médicament.
Ce paradoxe souligne une carence : les outils juridiques et politiques permettant de préserver le contrôle national sur les entreprises stratégiques demeurent insuffisants. En cédant Biogaran, la France prend le risque de fragiliser un pan essentiel de son autonomie sanitaire.