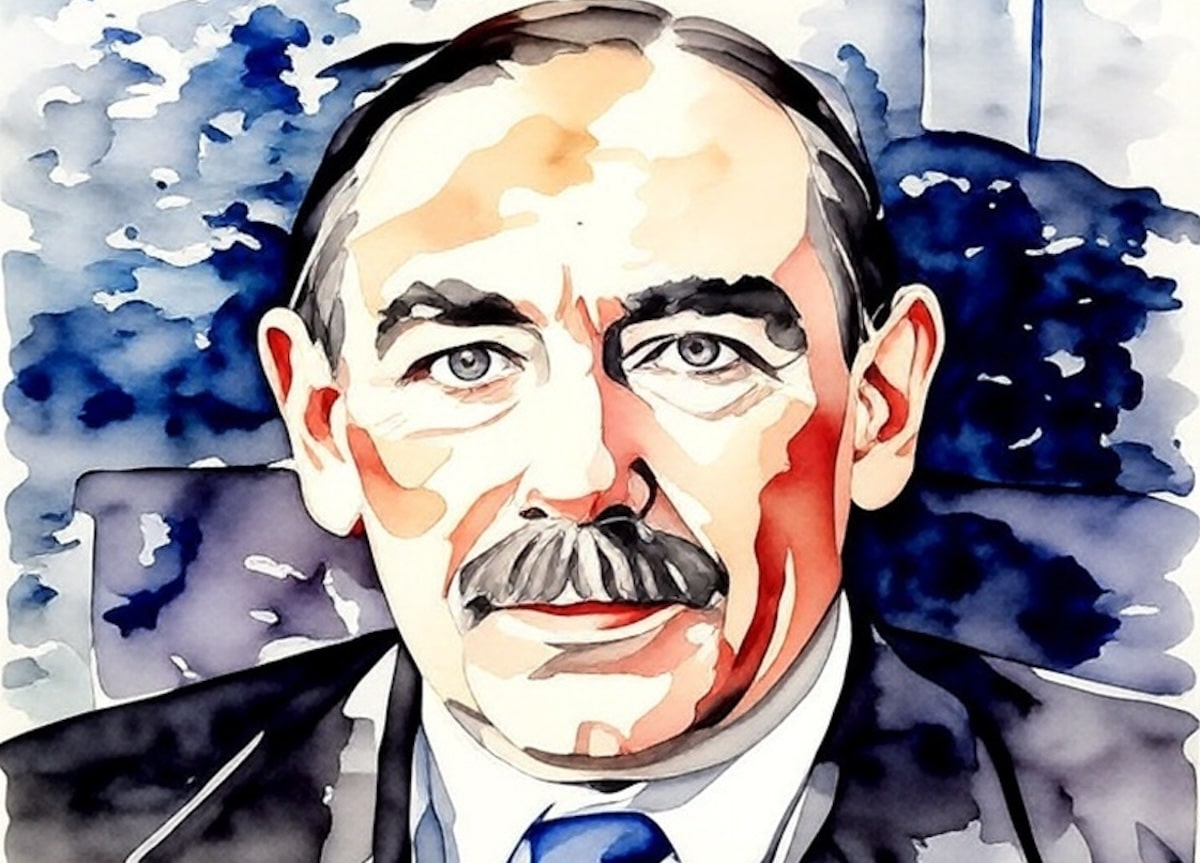Afficher le résumé Masquer le résumé
Qu’ont en commun la Grande Dépression des années 1930, les chocs pétroliers des années 1970, la crise financière de 2008, la pandémie de Covid-19 ou encore les plans climatiques aujourd’hui discutés à Bruxelles ou à Washington ? Tous marquent, à leur manière, le retour en force d’une pensée économique née il y a près d’un siècle : celle de John Maynard Keynes.
À chaque soubresaut majeur du capitalisme, les idées keynésiennes ressurgissent, comme une boîte à outils qu’on croyait rangée, mais jamais totalement oubliée. Croissance en panne, chômage persistant, inflation incontrôlée, endettement public massif : les États, sous pression, se tournent encore vers celui qui a théorisé l’intervention publique pour éviter les pires dérives des marchés.
Pourquoi, alors qu’il a été proclamé mort tant de fois, Keynes reste-t-il aussi incontournable ? Plus qu’un économiste, son œuvre est devenue une référence politique et sociale. Une boussole pour orienter l’action publique face à l’incertitude.
A LIRE AUSSI
Schumpeter, le retour en grâce d’un économiste visionnaire
Keynes, l’homme qui a défié l’économie classique
Né à Cambridge en 1883 dans une famille d’intellectuels, Keynes est un pur produit de l’élite britannique. Formé aux mathématiques, passionné par la philosophie et l’art, il traverse la Première Guerre mondiale comme haut fonctionnaire, puis comme négociateur à Versailles. Choqué par les sanctions imposées à l’Allemagne, il démissionne et publie en 1919 Les Conséquences économiques de la paix, un ouvrage prémonitoire qui annonce l’instabilité future de l’Europe.
Mais c’est la crise de 1929 qui le propulse au rang de figure mondiale. Alors que les théories dominantes peinent à expliquer l’effondrement économique, Keynes publie en 1936 La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie. Une révolution intellectuelle. Il y démonte l’idée que les marchés s’équilibrent d’eux-mêmes et montre pourquoi l’intervention de l’État est non seulement utile, mais indispensable.
Il finira sa carrière en acteur clé des accords de Bretton Woods en 1944, qui poseront les bases du système financier international d’après-guerre. Mais au-delà des institutions, son héritage est une méthode : penser l’économie dans l’histoire, avec ses crises, ses peurs et ses espoirs.
A LIRE AUSSI
Bourdieu, la clé pour comprendre les crises d'aujourd'hui
Ce que dit vraiment Keynes : trois idées-clés toujours en débat
1. La demande, pas l’offre, est le moteur principal
À rebours des économistes classiques qui croyaient à une auto-régulation naturelle des marchés, Keynes soutient que la production ne trouve pas toujours preneur. La demande globale – celle des ménages, des entreprises, et de l’État – est le véritable moteur de l’activité économique. Quand cette demande chute, comme après 1929 ou en 2008, l’économie peut rester durablement bloquée au ralenti, loin du plein emploi.
Face à ce blocage, Keynes propose une solution simple : relancer la demande par l’investissement public. C’est ce que les gouvernements ont tenté de faire en 2020 face à la crise sanitaire, en injectant massivement des milliards dans les économies à l’arrêt. Une stratégie encore discutée aujourd’hui à l’heure des transitions écologiques et technologiques.
2. L’incertitude structure l’économie, pas la rationalité
Keynes est aussi l’un des premiers à faire de l’incertitude un moteur central de l’économie. Contrairement à l’image d’acteurs parfaitement rationnels, il décrit des entrepreneurs guidés par des « esprits animaux », des anticipations souvent irrationnelles et changeantes.
Ces comportements expliquent les bulles financières et les crises soudaines. Du krach de 1929 à celui de 2008, en passant par l’explosion du bitcoin ou des marchés technologiques, les marchés financiers ressemblent parfois davantage à des casinos qu’à des espaces d’échange rationnels.
3. L’État stratège, garant de la stabilité économique
Face à ces dérives, Keynes plaide pour un État qui ne se contente pas d’observer, mais qui agit. Par la dépense publique, il peut soutenir l’activité en période de crise. Par la régulation financière, il peut prévenir les excès spéculatifs. Et par la politique monétaire, il peut ajuster les taux d’intérêt pour encourager ou freiner l’investissement.
Cette vision d’un État stratège, capable de piloter la macroéconomie sans étouffer l’initiative privée, reste aujourd’hui au cœur des débats sur le rôle des pouvoirs publics face aux grands défis économiques.
Des héritiers en ordre dispersé : qui est encore vraiment keynésien aujourd’hui ?
Depuis la mort de Keynes en 1946, ses idées ont connu plusieurs métamorphoses. Dès l’après-guerre, la « synthèse néoclassique » popularisée par Paul Samuelson tente de marier keynésianisme à court terme et retour aux mécanismes de marché à long terme. Le célèbre modèle IS/LM de John Hicks devient la grammaire des manuels d’économie, mais au prix d’une simplification extrême de la pensée keynésienne.
Face à cette synthèse, les post-keynésiens, comme Joan Robinson ou Hyman Minsky, revendiquent une lecture plus radicale. Pour eux, l’économie est structurellement instable, et le marché peut durablement fonctionner en sous-emploi. Ils remettent en cause la libéralisation financière et la mondialisation incontrôlée.
Depuis 2008, une nouvelle génération d’économistes, comme Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, défend un « néo-keynésianisme » pragmatique : relance budgétaire, régulation des marchés, lutte contre les inégalités. Mais cette ligne reste minoritaire face à l’orthodoxie budgétaire défendue par les institutions européennes ou le FMI.
Des idées revisitées à l’heure des crises écologiques et sociales
Le retour du keynésianisme ne se limite plus à la seule gestion des crises financières. Face à l’urgence climatique, certains appellent à une nouvelle lecture de Keynes. Le Green New Deal, popularisé aux États-Unis et en Europe, s’inspire directement de ses préceptes : un investissement public massif pour transformer l’économie et créer des emplois verts.
Cette vision bouscule le dogme de la croissance à tout prix. Peut-on être keynésien sans chercher une expansion infinie de la production ? Certains, comme les partisans d’un « keynésianisme écologique », proposent de réorienter la dépense publique vers la soutenabilité, en régulant les secteurs les plus polluants et en finançant la transition énergétique.
La réflexion porte aussi sur la démocratie économique : qui décide des grands investissements ? Peut-on laisser les marchés seuls orienter les choix d’avenir ? Ici encore, Keynes inspire une réflexion sur le rôle des États dans la définition d’une stratégie collective.