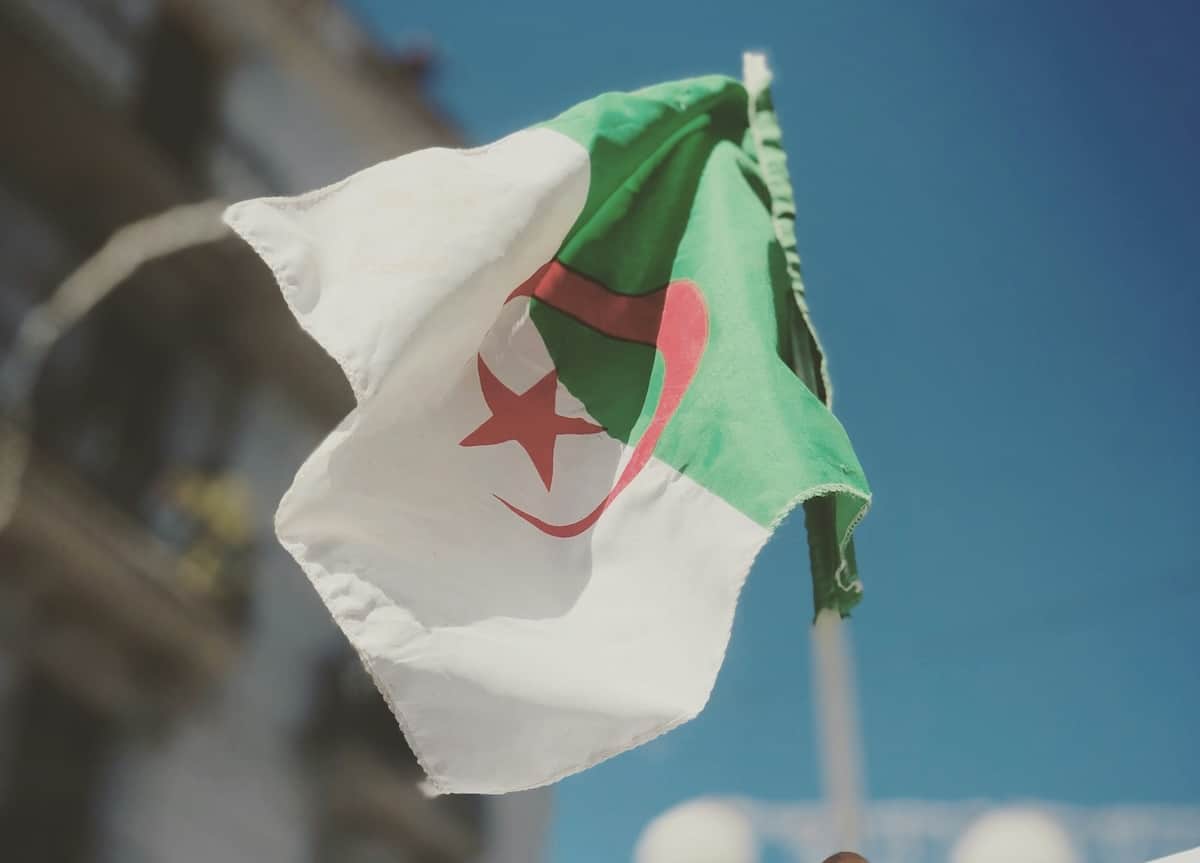Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Les signes étaient là, visibles, persistants. Ils disaient la fragilité d’un lien façonné par l’histoire, traversé de rancœurs, lesté d’ambiguïtés. En juillet 2024, la reconnaissance par la France du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental a été l’élément déclencheur d’une crise dont les racines plongent loin, bien au-delà de ce seul contentieux territorial. Ce geste politique, lourd de conséquences, a été perçu par Alger comme une provocation, une remise en cause explicite de ses intérêts et de son rôle régional.
Dès lors, les tensions ont suivi un cours prévisible : rappel de l’ambassadeur, menaces de rétorsion économiques, raidissement des discours. Mais cette crise ne se réduit pas à un enchaînement d’incidents diplomatiques. Elle révèle l’épuisement d’une relation où chaque différend, qu’il soit historique, économique ou migratoire, s’accumule sans jamais trouver d’issue.
A LIRE AUSSI
Géopolitique : où nous conduisent les populismes ?
2024-2025 : l’escalade
Le 30 juillet 2024, Paris officialise son soutien au plan marocain pour le Sahara occidental. En validant l’option de Rabat, la France se range aux côtés du Maroc contre la position algérienne, qui soutient le Front Polisario et revendique l’autodétermination du territoire.
La réponse ne tarde pas. Alger rappelle son ambassadeur, puis évoque des sanctions économiques. Un geste qui marque une rupture assumée, loin des crises passées où, malgré les tensions, les deux capitales maintenaient un dialogue. Cette fois, les positions sont irréconciliables.
En janvier dernier, un bras de fer diplomatique s’ouvre autour du refus algérien de réadmettre un influenceur accusé d’incitation à la violence en France. Paris exige sa prise en charge par Alger, qui s’y oppose.
Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, opte pour la confrontation, affirmant sa volonté d’imposer un « rapport de force ». Une déclaration qui alimente un climat déjà délétère, où la question migratoire s’impose comme un terrain d’affrontement privilégié.
En réponse aux réticences algériennes à délivrer des laissez-passer consulaires pour ses ressortissants expulsés de France, le gouvernement français brandit la menace d’un blocage des visas. Une mesure qui rappelle la réduction drastique des délivrances en 2021 et renforce la crispation entre les deux États.
Un passif colonial jamais soldé
À chaque crise, il resurgit. Plus de soixante ans après l’indépendance, le passé colonial continue d’empoisonner les relations franco-algériennes. Alger réclame toujours des excuses officielles pour les crimes commis durant la colonisation, là où Paris refuse une reconnaissance formelle qui ouvrirait la voie à des revendications juridiques et financières.
Ce différend n’est pas qu’un enjeu symbolique : il alimente un ressentiment profond, structurant l’image de la France en Algérie et réciproquement. D’un côté, une élite politique algérienne pour qui Paris incarne encore la domination coloniale. De l’autre, un pouvoir français qui instrumentalise ces tensions à des fins de politique intérieure, notamment sur la question migratoire.
L’Algérie et la France, visions opposées du Maghreb et du Sahel
L’Algérie accuse la France de chercher à maintenir une influence politique et économique dans la région en soutenant Rabat contre ses intérêts. Un reproche qui ne se limite pas au Sahara occidental.
Le rôle de Paris au Sahel est une autre source de tension. Alger conteste la présence militaire française dans cette région et critique son interventionnisme, y voyant une politique qui prolonge l’instabilité plutôt que de l’endiguer.
Une politique migratoire devenue terrain de confrontation
La question migratoire s’inscrit dans cette logique d’affrontement. Depuis plusieurs années, la France durcit les conditions d’entrée des ressortissants algériens, une évolution perçue comme une remise en cause implicite des accords bilatéraux.
La réduction des visas décidée en 2021 en est une illustration. Alger avait alors dénoncé une « provocation », refusant de faciliter les expulsions en retour. Le conflit actuel ne fait qu’exacerber cette tension latente.
Les tensions diplomatiques trouvent un écho dans l’opinion publique. Un sondage Ifop de janvier 2025 révèle que 71 % des Français ont une image négative de l’Algérie.
Le chiffre est significatif, révélateur d’une évolution où le discours sur l’Algérie s’est durci, notamment dans les milieux politiques de droite et d’extrême droite. Une rhétorique qui alimente une crispation généralisée autour des questions migratoires et identitaires.
Les conséquences pour la communauté algérienne en France
Ces tensions ont des répercussions directes pour les près de 2 millions d’Algériens vivant en France. Entre la réduction des visas et la multiplication des discours hostiles, le climat se détériore.
Un phénomène s’accentue : la migration inverse. Face à ces incertitudes, de plus en plus d’Algériens quittent la France pour l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la Turquie, où les conditions d’accueil sont perçues comme plus favorables.
Un point de non-retour ?
À court terme, les perspectives de réconciliation sont faibles. La crise actuelle s’inscrit dans un contexte politique où la montée des discours anti-immigration et la droitisation du débat public ne laissent guère de place à l’apaisement.
Une chose est sûre : jamais depuis l’indépendance la relation entre Paris et Alger n’a semblé aussi fragile.